LOL est sans doute l’acronyme le plus utilisé d’Internet, mais aussi le plus incompris. On a souvent perdu de vue sa signification originelle, et son usage excessif lui a fait perdre tout son sens. Sans vouloir froisser, on aurait pu espérer mieux qu’une expression censée exprimer l’hilarité, mais qui, neuf fois sur dix, trahit surtout une absence totale de rire. Comprendre l’origine et les usages de "LOL" aide à mieux saisir la communication digitale actuelle. Voici tout ce que vous devez savoir à son sujet — et surtout pourquoi il est indispensable (ou pas) de s’en soucier.
La signification littérale de LOL et ce que l'on préfère souvent ignorer 🤫
L'acronyme anglais « Laughing Out Loud » et ses déclinaisons
LOL, trois lettres qui n'ont de punch que dans la hâte d'un clavier fatigué. Soyons honnêtes, derrière cet acronyme pétillant se cache un sens littéral : « Laughing Out Loud » — autrement dit, rire franchement, à gorge déployée (mais sans aucun son, paradoxalement). L'ironie du destin numérique veut qu'à ses débuts, dans les années 1990 sur les premiers forums et chats d'Internet, "LOL" marquait une réaction sincère à un trait d'humour percutant. Le monde a changé, et LOL s'est transformé en simple virgule pour ponctuer ses hésitations ou combler le vide. Sans vouloir froisser les nostalgiques des BBS, qui s'en souvient encore sérieusement ?
Selon l'Oxford English Dictionary : « LOL. Abbreviation for ‘laugh(ing) out loud’: used especially in electronic communications to indicate that something is humorous. First recorded in 1993. »
On aurait pu espérer une révolution linguistique plus marquante. Les variantes n'ont pas tardé : « Lots of Love » pour ceux qui n'y comprenaient rien, « Lots of Laughs » dans les discussions familiales où l'humour passait au second plan.
Les traductions françaises : de « Mort de rire » à la simple interjection
Du côté francophone, la traduction la plus courante reste MDR (mort de rire). Cette adaptation, avouons-le, ressemble à une traduction scolaire mal inspirée. Elle ne capte ni l'instantanéité ni la neutralité émotionnelle de LOL ; elle surjoue le drame là où l'anglais reste plat et efficace. N'en déplaise aux puristes du digital bilingue, MDR ne sera jamais le clone parfait de LOL, car personne ne rit de la même façon d'une langue à l'autre ! Plus intéressant encore : en France comme ailleurs, LOL s'est imposé tel quel chez les moins de trente ans, supplantant sa pauvre traduction par une interjection universelle vidée de son contenu comique.
L'usage initial : quand LOL avait vraiment du sens
Ah, l'époque bénie où chaque LOL avait du poids ! À ses débuts – disons-le franchement – il était réservé à des éclats rares et authentiques devant un écran monochrome ou une interface IRC rugueuse. On ne riait pas pour un rien ; écrire « LOL » signalait un moment suffisamment fort pour sortir ce précieux acronyme du placard numérique. La banalisation actuelle fait sourire (ou pleurer), car autrefois il fallait bien plus qu’un jeu de mots éculé pour mériter un tel hommage écrit. On aurait souhaité mieux que cet abîme de fadeur où tout devient LOL… même l’ennui.
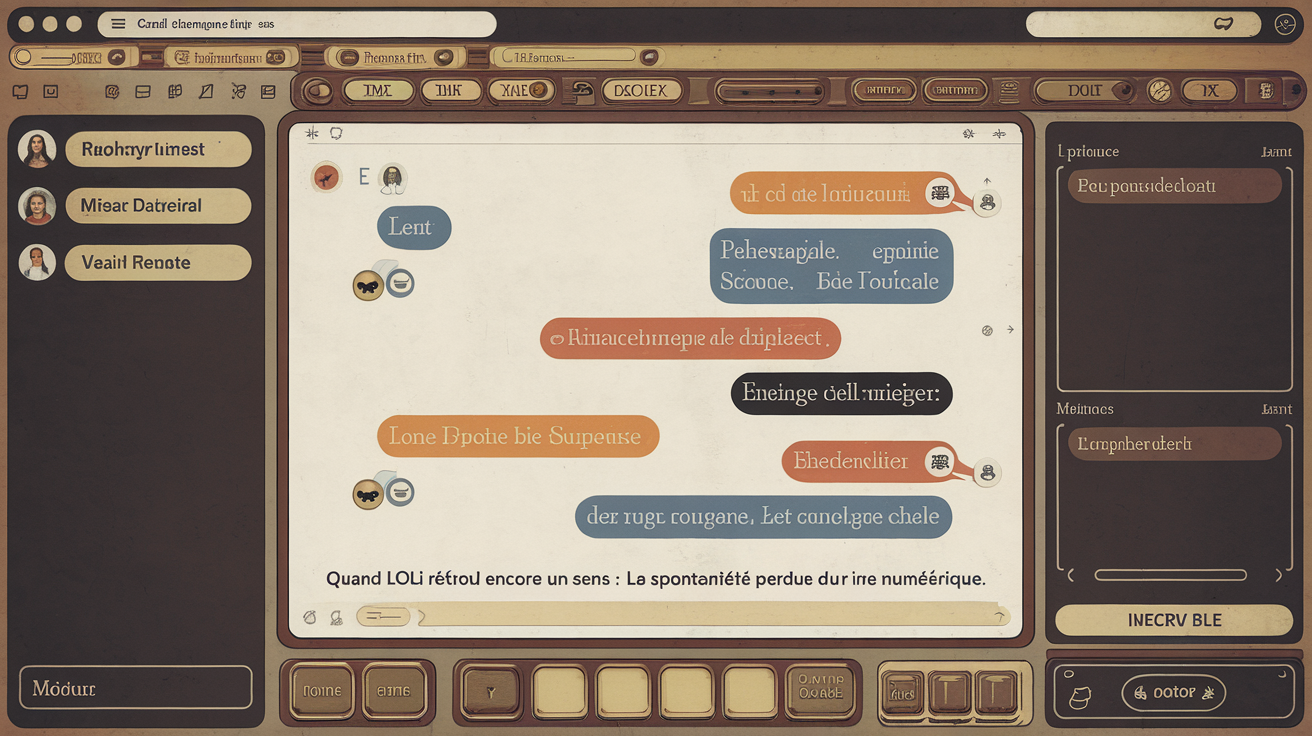
Quand LOL retrouvait encore un sens : la spontanéité perdue du rire numérique.
Les dérives et nuances de LOL : quand le rire devient habituel voire inexistant 🤨
LOL comme ponctuation : l'abus qui vide le sens
Il faut être honnête : LOL, vidé de sa substance, apparaît désormais à la fin de nombreuses phrases comme une simple virgule sans intérêt. En observant n'importe quelle discussion numérique — réseaux sociaux, messageries instantanées, forums — on constate que cet acronyme tente désespérément de créer une illusion de connivence ou de second degré. Il ne s'agit plus de rire, mais plutôt d'occuper l'espace, d'adoucir ses propos ou de masquer le vide du message. Reddit et certains linguistes amateurs l'avaient déjà remarqué depuis des années : « j'utilise instinctivement 'lol' comme ponctuation. » Sans vouloir froisser les inconditionnels du tout-numérique, on aurait espéré mieux qu'une telle déchéance expressive.
« LOL, pour masquer l'absence totale d'humour. »
LOL pour adoucir le discours : masquer l'hésitation ou la gêne
Il y a plus subtil que la simple ponctuation : LOL devient parfois un cache-misère émotionnel. On ajoute un « lol » en fin de phrase pour atténuer une remarque gênante, lisser une critique trop frontale ou signaler qu'on plaisante (alors qu'en réalité, ce n'est pas toujours le cas). Ce tic est devenu une arme passive-agressive redoutable dans les échanges numériques modernes ; il permet à chacun d'esquiver toute prise de position claire, tout en prétendant rester léger. Derrière chaque LOL mal placé se cache souvent une gêne ou un malaise soigneusement dissimulé.
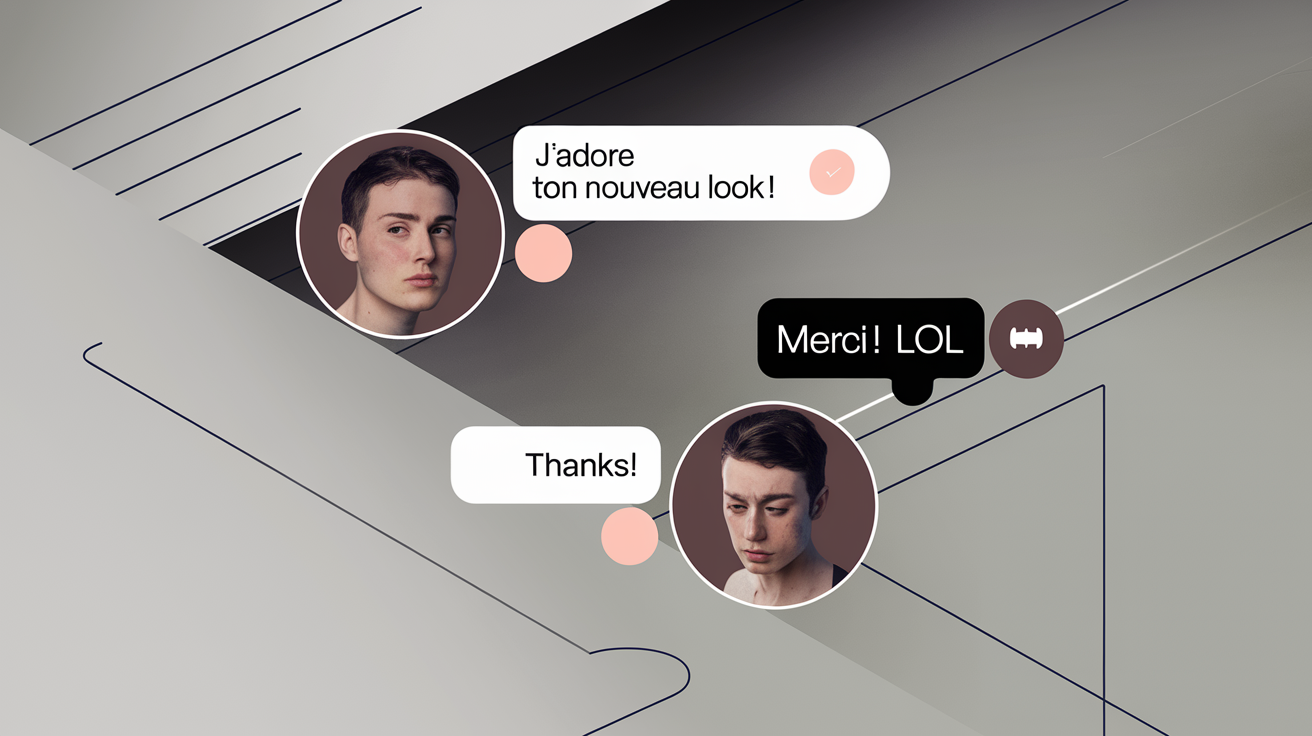
Quand « lol » sonne faux : ici, il sert surtout à noyer le poisson – et ça se voit.
Les variantes et créations dérivées : lolcats, lulz, loler...
Le phénomène LOL a engendré sa propre descendance — souvent bien plus inventive que son géniteur standardisé. Pour ceux qui aiment observer les mutations linguistiques :
- Lolcats : images de chats surmontées de textes en langage volontairement fautif, censées déclencher un rire primaire et universel.
- Lulz : emprunt cynique du mot par les trolls ; ici, le plaisir vient moins du rire que de la moquerie gratuite aux dépens d’autrui.
- Loler / Loliser : verbes issus du même moule (« j’ai lolé », « ça m’a trop lolisé »), preuve que la créativité syntaxique n’est pas totalement perdue – malheureusement souvent au ras des pâquerettes.
- ROFL / ROTFL : « Rolling On (The Floor) Laughing », sommet supposé du délire comique numérique – autant dire qu’on atteint rarement ce niveau dans la vie réelle.
- Lolwut / LOLOL : formes parodiques accentuant encore l’absurdité ou la répétition mécanique.
Sans vouloir froisser les puristes, cet ensemble constitue un observatoire fascinant de la plasticité (et parfois de la vacuité) du langage Internet contemporain !
L'intégration dans le langage courant et les dictionnaires : consécration ou banalisation
Il fallait bien qu’un jour cela arrive ! Le Robert illustré accueille désormais fièrement « LOL » en tant qu’interjection dans son édition papier – preuve irréfutable que l’acronyme a dépassé la culture geek pour toucher le grand public. Cependant, n’est-ce pas à ce moment précis que commence sa dégradation qualitative ? L’omniprésence de LOL marque-t-elle son ancrage définitif ou plutôt la perte totale de son sens ? Lorsque même le dictionnaire consacre ce qui était autrefois subversif puis simplement drôle, cela pourrait bien être le baroud d’honneur d’un acronyme devenu paresseux.






