On aurait pu rêver mieux, mais le kakemono reste l’un des supports les plus efficaces qui soient. À condition d’en maîtriser les codes et les usages, tout en gardant à l'esprit que l'esthétique doit servir l'efficacité. La croyance (erronée) que tout le monde sait créer un kakemono visible et pertinent en claquant des doigts. La tendance à sacrifier le design et la hiérarchisation de l’info sur l’autel du moche et du surchargé. L’illusion qu’un beau fichier suffit, sans se soucier de l’usage final ni de la lisibilité dans la durée. On vous dévoile notre méthode en 2000 mots.
Qu'est-ce qu'un kakemono, au-delà de son nom exotique ?
Un kakemono n'a rien d'une simple invention marketing sortie d'un brainstorming sous-caféiné. Le mot, importé sans vergogne du japonais ("objet suspendu"), renvoie à l'origine à une œuvre picturale ou calligraphique soigneusement déroulée et accrochée dans un coin de temple ou de maison bourgeoise au Japon ou en Chine. Une pièce unique, destinée à être contemplée — pas à attirer les badauds lors d'une foire commerciale. Sans vouloir froisser les amateurs de folklore, le kakemono originel relevait autant de la contemplation esthétique que du signal visuel discret. Aujourd'hui, on a troqué l'encre sur soie pour du PVC bon marché et des visuels criards. En France comme ailleurs, ce mot pompeux désigne la plupart du temps un vulgaire "roll up" ou une bannière verticale destinée à encombrer les allées des salons pro.
Pourquoi le kakemono reste-t-il un pilier de la communication visuelle ?
Malgré son glissement sémantique et matériel franchement triste, le kakemono demeure un incontournable des stratégies PLV actuelles. Sa verticalité fait encore recette : il s'impose dans des mondes saturés (stands d'expo, points de vente) où la visibilité est une denrée rare et chèrement disputée. On aurait pu rêver mieux que ce recyclage marketing paresseux mais force est de constater qu’un kakemono correctement exécuté attire et retient l’œil. Flexible (on le transporte sous le bras), rapide à installer (30 secondes chrono si vous n’êtes pas manchot), il se plie à toutes les fantaisies événementielles ou commerciales.
Un kakemono bien conçu capte l'attention dans un environnement saturé de stimuli visuels.
Sans vouloir sombrer dans l’éloge facile : c’est précisément parce qu’il est devenu banal qu’il faut redoubler d’effort sur sa conception.
Les différents types de kakemonos : du rouleau au drapé élégant
La diversité des formats n’a rien d’époustouflant mais mérite d’être clarifiée :
- Kakemono déroulant (roll up) : portable, montable en deux gestes fatigués ; starlette des salons qui ne brille jamais longtemps.
- Kakemono suspendu : version murale ; plus élégante mais souvent ignorée par ceux qui pensent que la hauteur suffit à tout régler.
- Kakemono extérieur : matériau renforcé (PVC 510 g/m² conseillé), censé résister aux aléas climatiques — jusqu’à ce que la première rafale lui fasse prendre la tangente.
Bien que peu inventifs, ces formats partagent un objectif commun : capter l’attention ou, à défaut, meubler l’espace.
La Fabrication d'un Kakemono : Les Petits Secrets des Pro (Sans les bla-bla inutiles) ✍️
Étape 1 : La Conception sans faute – Le fond avant la forme (ou presque)
On croirait rêver, mais la majorité des briefs pour kakemonos commencent par "il nous faut un visuel sympa". Sans vouloir froisser, personne n'achète sur un joli fond si le message est flou ou hors sujet. Avant de lâcher Illustrator comme un forcené, il s’agit de définir – noir sur blanc – ce que l’on cherche à communiquer et à qui. Est-ce que vous voulez attirer un passant pressé ? Informer sur une nouveauté ? Convaincre d’acheter, ou simplement faire exister votre marque dans une jungle de concurrents aux bras chargés de goodies ?
Le message-clé doit être identifiable en moins de trois secondes montre en main — au-delà, c’est perdu. La cible doit être cernée précisément : parler à tout le monde, c’est ne parler à personne, et ce mantra s’applique ici avec une cruauté sans filtre.
Étape 2 : La Structure et le Sens de Lecture – L'œil ne doit pas errer
Le kakemono efficace ne laisse pas l’œil papillonner au hasard. Sans structure claire, on obtient un patchwork indigeste qui détourne l'attention. Respect du sens de lecture — vertical en France — et hiérarchisation stricte sont obligatoires.
Les éléments d’un bon flux visuel dans un kakemono :
1. Point d’accroche principal (souvent en haut centré ou à gauche pour capter immédiatement l’œil).
2. Message clé parfaitement lisible (évitez les phrases interminables ou les slogans abscons).
3. Appel à l’action lisible et direct (« Découvrez », « Essayez », etc.).
4. Logo positionné avec intelligence, ni trop discret ni envahissant.
Un bon design impose sa logique : le regard plonge du titre vers le message central avant d’atterrir gentiment sur la signature visuelle.
Étape 3 : Le Design qui frappe juste – Logo, visuel, message : l'ordre des priorités
Si vous pensez que plus il y a de couleurs plus ça claque… détrompez-vous ! Les couleurs doivent être choisies dans votre charte graphique ou, au pire des cas, selon leur capacité à contraster fortement avec le fond pour garantir la lecture à distance (bleu roi sur blanc, noir sur jaune… mais jamais bleu foncé sur gris sale). Quant aux polices : priorité absolue à la lisibilité. On bannit Comic Sans MS et autres insanités typographiques pour les titres.
L’image centrale doit avoir du sens (sans pixelisation ni flou disgracieux). Inutile d’afficher trois photos pour illustrer LA même idée ou un produit minuscule perdu dans un océan vide.
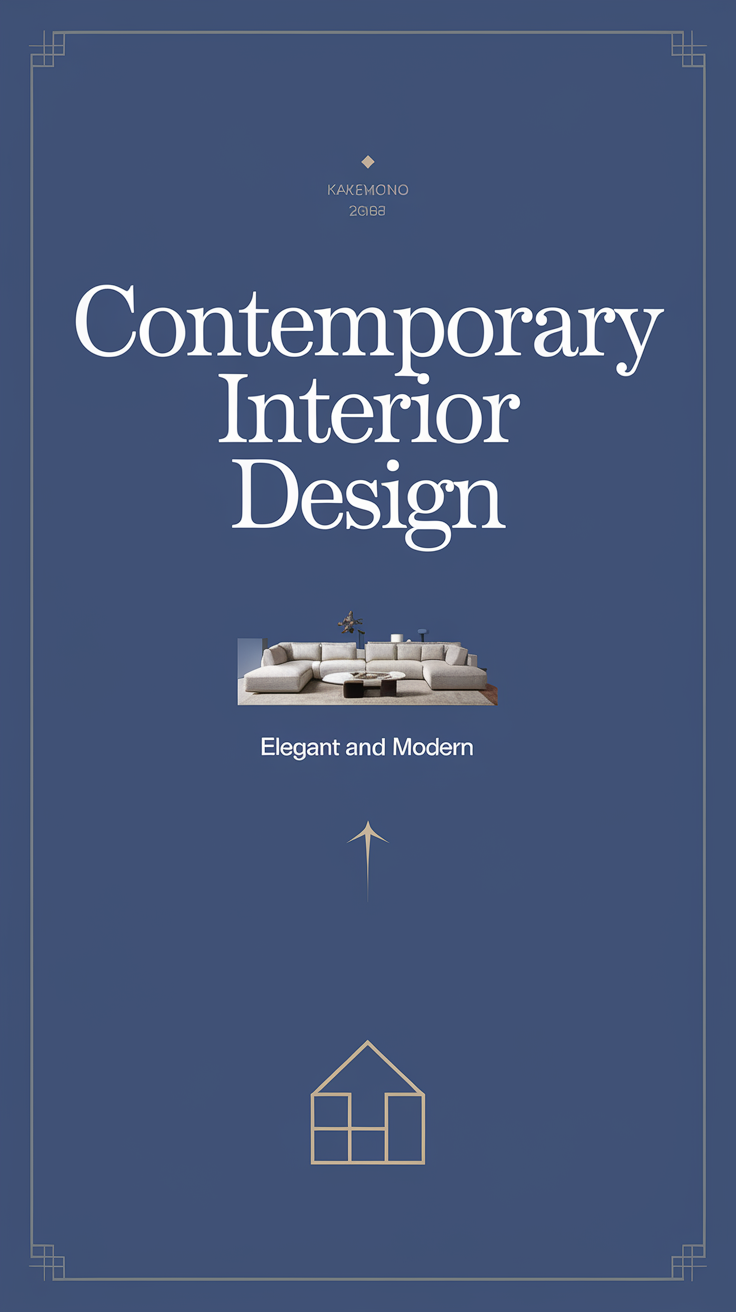
Malheureusement, de nombreuses entreprises négligent cette étape, produisant des supports illisibles dès deux mètres.
Étape 4 : Le Choix Crucial des Matériaux et des Dimensions – Le diable est dans les détails
Encore sous-estimé ! Pourtant choisir son matériau équivaut à choisir son armure : PVC 510 g/m² pour la robustesse intérieure/événementielle, bâche micro-perforée pour affronter l’extérieur sans transformer son kakemono en voile de planche à voile dès la première brise ; tissu imprimé pour une touche premium presque snob (et souvent sous-exploitée).
Les dimensions ont leur importance stratégique : trop petit = invisible ; trop grand = ridicule et encombrant (certains salons vous recalent direct si vous débordez). Pour la structure : aluminium anodisé reste une valeur sûre côté perception qualitative.
| Matériau | Durabilité | Usage | Rendu visuel |
|---|---|---|---|
| PVC 510 g/m² | Très bonne | Intérieur/extérieur | Couleurs franches |
| Bâche micro-perforée | Excellente dehors | Extérieur venté | Légère perte d’éclat |
| Tissu polyester | Bonne | Intérieur/premium | Effet textile élégant |
Un kakemono en tissu peut durer plusieurs salons, tandis qu'un PVC bas-de-gamme peut se détériorer dès le premier montage. Investir dans un matériau de qualité est toujours payant pour préserver sa crédibilité.
Les Pièges à Éviter pour un Kakemono qui ne finit pas à la poubelle 🚩
La surcharge visuelle : quand trop, c'est trop.
Sans vouloir froisser, il faut vraiment avoir un sens du sabotage bien affûté pour croire qu’un kakemono bourré d’informations aura plus d’impact. On tombe systématiquement dans le piège du "plus c'est complet, mieux c'est", alors que la seule conséquence palpable est… l’illisibilité. Un kakemono efficace fait le tri : message condensé, imagerie réduite à l’essentiel, espaces de respiration. Il n’y a rien de plus contre-productif qu’un visuel trop dense : chaque élément superflu parasite le reste et noie ce qui aurait pu être percutant. Les études sur la communication visuelle sont formelles : l’œil décroche devant la saturation. Le visiteur pressé n’a ni le temps ni l’envie de déchiffrer un inventaire digne d’un mode d’emploi Ikea.
Un kakemono surchargé d'informations et de visuels garantit que le spectateur ne retiendra rien. Évitez le brouillard visuel.
La typographie illisible : le comble de l'absurdité marketing.
Soyons honnêtes, l’usage de typographies inadaptées relève de l’incompétence pure et simple – mais cela ne semble pas gêner les amateurs du tape-à-l’œil inutile. Un lettrage mal choisi (trop fin, pailleté ou pseudo-manu) détruit toute tentative de lisibilité et plombe le message avant même qu’il n’ait une chance d’être compris. C’est jouer contre son camp ; or un kakemono doit frapper vite et juste.
- Privilégier les polices sans-sérif pour les titres et messages courts.
- Utiliser des polices lisibles et aérées pour les corps de texte plus longs (si nécessaire).
- S'assurer d'un bon contraste entre le texte et le fond.
Rares sont ceux qui s'arrêtent pour relire un texte écrit en script rose pâle sur fond blanc cassé.
L'oubli du contexte : un kakemono pour quoi faire ?
Croire qu’un joli fichier PDF se suffit à lui-même est le summum de la naïveté créative. Le contexte d’utilisation doit piloter chaque choix graphique et technique : on ne conçoit pas un support pour une foire en intérieur comme on imagine une bannière pour lampadaire urbain. Lumière crue des salons, pluie battante dehors, distance réelle de lecture — tout influe sur la forme finale. Trop souvent ignorée, cette réflexion contextuelle conditionne pourtant la durée de vie ET l’utilité du kakemono : matériaux renforcés pour extérieur (sinon bonjour les dégâts), format adapté au mobilier ou aux structures déjà présentes… On aurait pu penser que c’est évident — manifestement non !

Optimiser son Kakemono : Les Astuces d'Ariane pour qu'il ne soit pas qu'un beau drapé
Comment faire pour que votre logo ne soit pas perdu au milieu du chaos ?
Soyons lucides, le logo n'est ni un sticker décoratif ni une signature en filigrane à reléguer dans un coin invisible. La plupart des kakemonos ratent leur entrée parce que le logo flotte quelque part, écrasé ou déformé, entre deux images sans saveur. Sans vouloir froisser, la règle d’or (visiblement ignorée par une foule de graphistes auto-proclamés) : logo en haut — c’est là que l’œil va naturellement. Pas besoin de le grossir à outrance, mais il doit s’imposer, être lisible et net même à cinq mètres. On n’y trompe pas : la reconnaissance de marque commence ici, comme l’ont compris les marques asiatiques qui placent systématiquement leurs logos là où aucun concurrent ne peut les snober.
Règles pour un logo bien intégré :
- Position stratégique (souvent en haut).
- Taille proportionnelle au support, mais visible.
- Pas d'effets superflus qui le dénaturent.
Utiliser les couleurs pour un impact maximal, sans tomber dans le criard.
Les couleurs sont tout sauf accessoires : elles polarisent l’attention et fixent votre discours visuel plus sûrement qu’un slogan mal torché. Le choix des teintes ne doit rien au hasard — on utilise la charte graphique, point final. Les tons vifs attirent mais l’excès fatigue ; ce sont les contrastes qui boostent la lisibilité et non une avalanche arc-en-ciel sortie d’un atelier maternelle. On aurait pu rêver mieux que ces kakemonos où chaque couleur crie plus fort que la précédente, c’est l’harmonie qui fait autorité.
Hiérarchiser l'information : le cheminement logique de l'œil du spectateur.
Vous voulez un support efficace ? Commencez par guider franchement le regard. On ne s’y trompe pas : plus c’est gros et placé en haut, plus c’est important — c’est élémentaire mais si souvent ignoré… Les infos secondaires descendent logiquement et sont appuyées par des contrastes ou des variations de taille/poids typographique. Sans vouloir froisser, ignorer ces principes fait de votre kakemono un puzzle illisible qui file direct au rebut.
Principes de hiérarchisation :
- Plus grand/visible = plus important.
- Placement stratégique des éléments clés.
- Utilisation de contrastes pour attirer l'attention.
Le texte doit-il être court ? Oui, et pourquoi.
On aurait pu penser que ce point était acquis… Hélas ! Un kakemono n’est pas une brochure. Personne ne s’arrête lire trois paragraphes format dissertation alors qu’il traverse un salon bondé ou qu’il longe un trottoir venteux. Il faut frapper court : une phrase d’accroche incisive, un appel à l’action limpide (« Découvrez notre offre », « Essayez maintenant »), et basta. L’essentiel se lit en deux secondes ou disparaît dans la masse — c’est implacable.
Ce qu'un texte de kakemono doit contenir :
- [ ] Un slogan accrocheur.
- [ ] Un appel à l'action clair (ex: 'Visitez notre site', 'Découvrez nos offres').
- [ ] Les informations de contact essentielles (nom, site web).

Kakemono : L'Art de Rendre l'Information Efficace et Durable 💡
Les erreurs courantes dans la fabrication de kakemonos.
Sans vouloir froisser, croire que n'importe qui peut réussir un kakemono d'impact relève du fantasme collectif. Les bourdes sont toujours les mêmes et méritent d'être affichées dans le hall d'entrée de toute agence, histoire d'éviter aux nouveaux venus de réinventer la roue… carrée.
Les erreurs à bannir pour votre kakemono :
- Trop d'informations : vouloir tout dire revient à ne rien dire.
- Polices illisibles ou trop originales (adieu lisibilité, bonjour migraine).
- Mauvaise utilisation des couleurs, qui noient le message au lieu de le sublimer.
- Visuels flous ou pixelisés, effet amateur garanti dès deux mètres.
- Ignorer la cible et le contexte réel d'utilisation (salon pro ≠ rue passante !).
On aurait pu rêver mieux… Mais non. La réalité prouve chaque jour que confier ce travail à un « bricoleur » finit quasi systématiquement en support jetable, et — soyons honnêtes — c'est du gâchis pur jus.
Le contrôle qualité avant impression : ne nous laissons pas berner.
Avant d'envoyer quoi que ce soit chez l'imprimeur, une relecture obsessionnelle s'impose. On ne s'y trompe pas : un visuel parfait à l'écran peut virer au désastre une fois imprimé si on néglige une faute, un mauvais réglage CMJN ou une image basse résolution. S'assurer que le fichier respecte toutes les contraintes (dimensions exactes, marges de sécurité, profils colorimétriques, résolution minimale) est la moindre des choses — pourtant beaucoup sautent cette étape comme si cela n'avait aucune incidence. Sans contrôle qualité digne de ce nom, vous pouvez déjà préparer la corbeille…
Quand faire appel à un professionnel ? La réponse est probablement plus souvent que vous ne le pensez.
Soyons honnêtes : si vous n'êtes pas graphiste confirmé ou si votre ambition dépasse la simple décoration murale du local syndical, faites appel à un pro. Un designer compétent va éviter tous les pièges évoqués ci-dessus, hiérarchiser vos infos avec discernement et adapter le rendu à l'objectif réel (événementiel haut-de-gamme ou promotion basique). Croire qu'on économise sur ce poste relève de l’erreur stratégique classique — on aurait pu rêver mieux qu’un logo pixellisé flottant dans le vide ou des couleurs improbables façon fête foraine.
Ariane Montclair : Personnellement, quand je vois un kakemono mal pensé, ça me donne des boutons. Faire appel à un vrai professionnel, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement pour la crédibilité de votre marque.
Le Mot de la Fin : Un Kakemono, un Véritable Outil, Pas une Simple Déco 🧐
On pourrait croire que le kakemono n’est qu’un gadget visuel parmi d’autres. C’est oublier une vérité évidente : bien conçu, il s’impose comme l’un des rares objets réellement capables de marquer les esprits dans le chaos ambiant. Sans vouloir froisser les amateurs de solutions rapides, on ne s’y trompe pas : ce n’est ni la taille ni la quantité de couleurs qui font la différence, mais l’intelligence stratégique derrière chaque choix. Le kakemono efficace ne se contente jamais d’être joli ; il capte, hiérarchise et frappe là où il faut – ce qui demande infiniment plus de soin qu’une simple impression à la chaîne.

- Objectifs et message clairs (sinon, à quoi bon ?)
- Hiérarchie visuelle sans faille
- Typographies et couleurs maîtrisées
- Matériaux adaptés au contexte, jamais choisis au hasard
- L’appui d’un professionnel quand le doute s’installe.
On aurait pu rêver mieux que tous ces supports vite faits-mal faits qu’on croise partout. À vous de prouver que même un « bête kakemono » mérite enfin le respect dû à un vrai outil de communication. Soyez exigeant : c’est dans l’exécution que réside tout le pouvoir…






