On ne compte plus les entreprises qui se revendiquent "pure players". Pourtant, la plupart se fourvoient — parfois volontairement. Et pour cause : la définition originelle de ce modèle est l'une des plus strictes qui soient. Alors, pourquoi est-ce important ? Car (se) raconter une histoire d'entrepreneur(e)s "pure players" revient à ignorer les opportunités immenses qu'offre le modèle "Click-and-Mortar". On vous explique tout.
Pure Player : Définition et origine
On aurait pu rêver d’un terme plus raffiné pour désigner l’élite du business 100% numérique, mais non : le monde a hérité de « pure player », anglicisme sorti tout droit des années 2000 et adopté avec un certain snobisme par nombre de consultants et de comités éditoriaux – à commencer par la sacro-sainte Commission d’enrichissement de la langue française, qui n’a pas cillé en entérinant cette nouveauté dans le Journal officiel. Sans vouloir froisser les amateurs de jargon, rappelons que ce néologisme est issu de « pure play », désignant initialement en finance une société concentrée sur une seule activité ou un secteur exclusif. Dans la jungle du web marchand, on a donc plaqué l’étiquette sur les entreprises dont l’activité commerciale se déroule uniquement – vraiment uniquement – en ligne, sans boutique, sans showroom, sans magasin de province ni de flagship sur les Champs-Élysées. Voilà le décor planté.
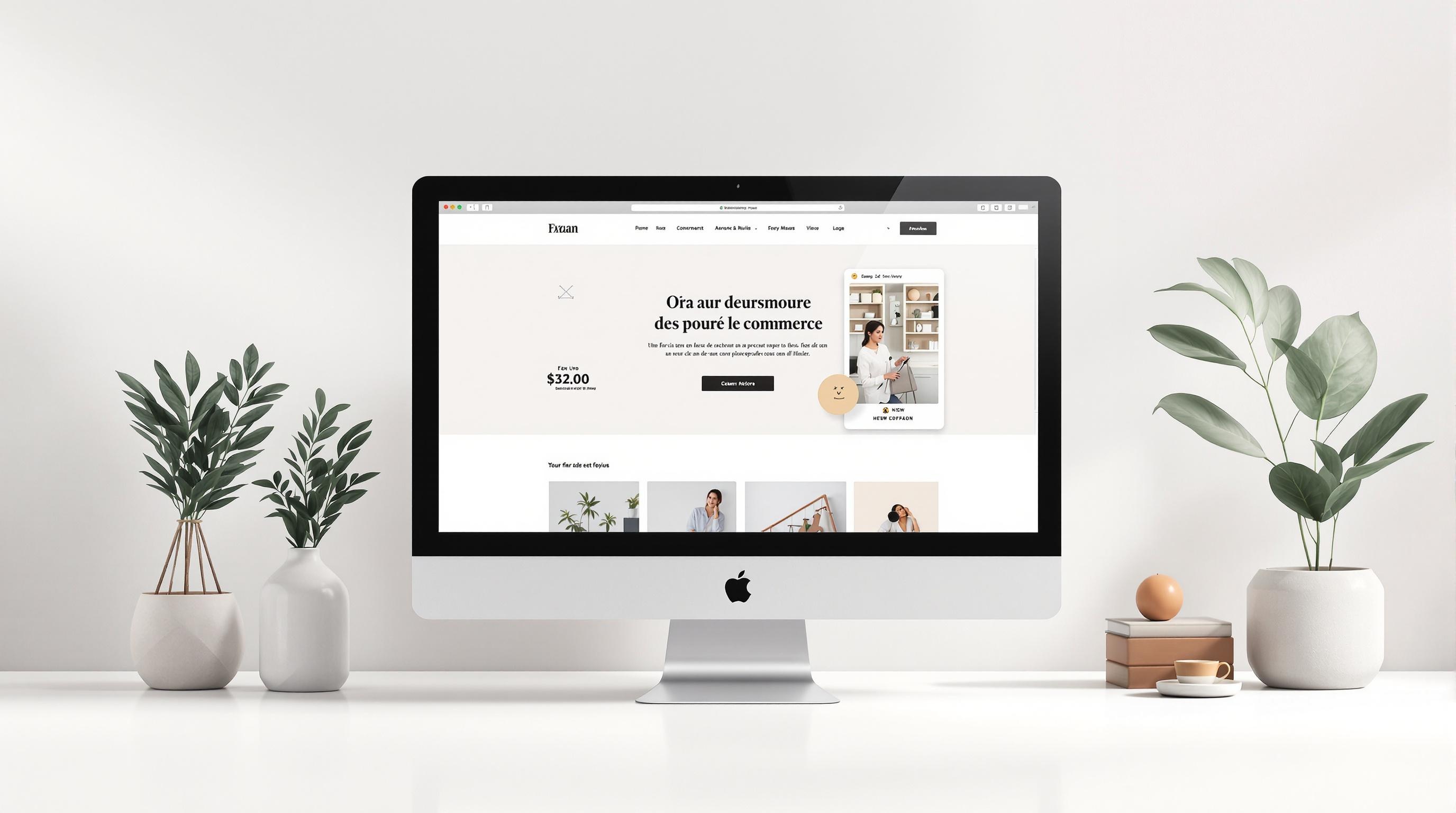
« Être un pure player, c’est vivre et mourir par le canal internet, sans filet physique. » (Citation apocryphe d’un analyste anonyme du web)
Origine et signification : un modèle d’exclusivité
L’essence du « pure player » tient tout entière dans cette promesse : une activité conçue pour le web, pensée dès le départ pour exploiter la puissance (et parfois la brutalité) du commerce numérique. Au contraire des enseignes traditionnelles qui se sont découvertes tardivement une passion pour la vente en ligne, le pure player ne trahit jamais son ADN digital natif. Il ne s’adapte pas, il naît digital. Historiquement, ceux qu’on qualifiait ainsi étaient marginaux voire suspects aux yeux du CAC 40 – aujourd’hui ils font figure de modèles à suivre… jusqu’à ce que la prochaine hype prenne leur place.
Ce que n’est pas un pure player : clarifier les idées reçues
Sans vouloir froisser ceux qui se gargarisent trop vite de terminologies tendance : non, avoir un site web ou vendre trois mugs sur Amazon ne fait pas de vous un pure player. Une entreprise traditionnelle qui ouvre une vitrine digitale ou s’essaie au click & collect reste fondamentalement hors-jeu de cette catégorie restreinte. La confusion persiste pourtant jusque dans certaines agences marketing qui alignent les plateformes comme autant de preuves d’innovation… Mais soyons honnêtes : l’essentiel n’est pas là.
L’essence du pure player : une activité et un canal unique
Le fantasme entretenu autour du modèle « one channel » est tenace : on veut croire à l’agilité extrême et aux économies salvatrices qu’offre cette verticalité absolue… Mais avouez-le : cette simplicité radicale peut aussi s’avérer terriblement fragile face aux évolutions imprévisibles du marché ou à la volatilité des clients numériques.
Caractéristiques clés d’un pure player
- 100% digital : aucune boutique ni présence physique.
- Focalisation exclusive sur un canal, internet dans (presque) tous les cas.
- Agilité organisationnelle, rendue possible par l’absence d’infrastructures lourdes.
- Innovation centrée web, optimisation continue des parcours et expériences digitales.
L’ADN du pure player : une naissance digitale
Ce détail tue toute ambiguïté : on ne devient pas vraiment un pure player par opportunisme ou rattrapage tardif. Impossible pour Darty ou Carrefour d’effacer leur histoire bétonnée pour renaître vierges sur Amazon Web Services ! Les purs produits du Net partagent ce patrimoine génétique commun : conception originelle autour des codes numériques, process taillés exclusivement pour les cycles courts et rapides imposés par Internet…
Anecdote mordante : lors d’une réunion internationale il y a quelques années à Paris La Défense (un lieu où fleurissent plus sûrement les acronymes que les idées neuves), j’ai entendu le CMO d’une grande chaîne retail souffler timidement qu’ils étaient « en train de devenir un pur-player mixte ». Cette chimère syntaxique prouve au moins une chose : même chez les dirigeants embarqués dans la transformation digitale depuis dix ans, personne n’est jamais vraiment sûr d’avoir compris où commence (et surtout où finit) l’exclusivité numérique… On ne s’y trompe pas.
Pure Player vs. les autres : comparaison des modèles numériques
Le rival historique : le "Brick and Mortar", l'incarnation physique.
Sans vouloir froisser les nostalgiques du centre-ville, rappelons que le modèle "brick and mortar" incarne la quintessence de l'expérience tangible : des boutiques en dur, des vendeurs en chair et en os, une caisse enregistreuse qui grince gentiment sous les tickets de caisse. On parle ici d'entreprises dont la survie dépend des mètres carrés occupés dans nos agglomérations – pas d'une ligne de code ni d'un algorithme de recommandation bancal. Leurs transactions sont physiques, leur gestion logistique se mesure en palettes et en cartons, pas en bande passante. Soyons honnêtes : ce modèle n’est pas mort mais il sent un peu la naphtaline dès qu’on prononce le mot « omnicanal ».

Le cousin hybride : le "Click and Mortar", le bâtisseur de ponts.
Parlons du fameux "click and mortar" : ce modèle s’amuse à jouer sur deux tableaux, oscillant entre vitrines éclairées au néon et interfaces digitales plus ou moins ergonomiques. Concrètement, ce sont ces enseignes que tout le monde connaît – Fnac, Darty, Boulanger, Ikea – qui ont compris qu'il valait mieux ne pas tout miser sur la queue aux caisses ni sur l’odeur du neuf dans les rayons. Elles investissent simultanément dans l’e-commerce et dans leurs points de vente historiques. Résultat : elles doivent jongler avec la complexité d’une double logistique, garantir une expérience cohérente entre magasin et site web (souvent raté d’ailleurs), et supporter des coûts fixes conséquents, tout en se rêvant championnes de la relation client personnalisée… On ne s’y trompe pas : c’est un numéro d’équilibriste où l’innovation côtoie souvent la cacophonie opérationnelle.
Impact du digital sur le retail traditionnel
| Modèle | Canal principal | Origine | Relation client |
|---|---|---|---|
| Pure Player | 100% digital | Natif web | Dépersonnalisée/Automatisée |
| Brick & Mortar | Physique | Traditionnelle | Présentielle/Humaine |
| Click & Mortar | Physique + Digital | Hybride | Mixte/Personnalisation difficile |
Clarification : un pure player n’est pas forcément une niche ou une startup
Non, Amazon n’est pas un projet de niche monté dans un garage par trois étudiants insomniaques. Et non, le fait qu’une entreprise opère uniquement en ligne ne dit rien – absolument rien – de sa taille réelle ni même de son secteur ! Un pure player peut dominer la planète (Amazon) ou prospérer modestement dans une micro-niche hyper-spécialisée (prenez les sites obscurs vendant exclusivement des graines bio pour perruches : ils existent). Sans vouloir froisser ceux qui adorent coller des étiquettes hâtives : parler de pure player renvoie juste à une structure opérationnelle mono-canal – rien à voir avec l’audace entrepreneuriale ou la taille critique.
Avantages et inconvénients des modèles numériques
Soyons lucides : chaque camp a ses armes… et ses failles béantes.
- Pure Player :
- Atouts : souplesse extrême, coûts fixes minimaux (pas de loyers ruineux ni d’armées de vendeurs), capacité d’itération rapide sur tous les aspects du parcours client digital.
- Faiblesses : dépendance totale au digital (bonjour les bugs critiques !), moindre capital confiance auprès des clients qui aiment voir pour croire, fragilité face à une concurrence dotée d’un maillage physique massif.
- Brick and Mortar :
- Atouts : expérience humaine irremplaçable (démonstration produit, conseil personnalisé), ancrage local fort, fidélité basée sur le contact réel.
- Faiblesses : coûts structurels élevés, rigidité extrême face aux évolutions technologiques rapides, difficulté à capter une clientèle hyper-mobile.
- Click and Mortar :
- Atouts : capacité à ratisser large (online/offline), possibilité d’amortir l’investissement entre plusieurs canaux, synergies logistiques potentielles si tout va bien…
- Faiblesses : double complexité organisationnelle permanente, risques d’incohérences multiples (prix différents selon canal ? Ruptures mal gérées ?), investissements massifs nécessaires juste pour rester compétitif – sans garantie aucune que cela suffira face aux géants digitaux purs comme Amazon ou Zalando.
Les visages du pure player : entre réalité et fiction
Les géants qui ont redéfini le jeu : Amazon, eBay, et leurs héritiers.
On ne s'y trompe pas : quand il s'agit d’illustrer le pure player dans toute sa brutalité numérique, Amazon et eBay écrasent la concurrence. Amazon est l’exemple chimiquement pur du modèle : absence totale de points de vente physiques (du moins jusqu’à ses velléités récentes avec Whole Foods, mais ne chipotons pas), optimisation industrielle de la logistique, et une capacité à tout vendre – du grille-pain à la production audiovisuelle. Ce n’est pas un hasard si Amazon a pulvérisé tous les records de croissance en France comme ailleurs, transformant chaque pixel d’écran en opportunité commerciale. Quant à eBay, il a révolutionné l’acte d’achat en ligne dès les années 90, misant tout sur l’intermédiation C2C mondiale avant même que « marketplace » ne devienne un mot à la mode. Leur secret ? Focalisation extrême sur le canal internet, industrialisation des process numériques et une expérience utilisateur taillée pour l’addiction transactionnelle. Voilà des pure players dont le succès n’a rien laissé au hasard.

« Le pur digital crée des empires à partir de lignes de code – mais il peut aussi disparaître sans laisser d'adresse physique » (Observation personnelle lors d’un audit pour une DNVB qui croyait rivaliser avec Jeff Bezos…)
Les pionniers français : La Redoute, une métamorphose commentée.
Sans vouloir froisser nos lecteurs patriotes : La Redoute mérite sa place au panthéon des transformations digitales réussies. Passée d’un mastodonte du catalogue papier à un acteur 100% e-commerce (plus de 94% des ventes réalisées en ligne dès la fin des années 2010), l'entreprise a dû sabrer ses racines pour survivre. Le virage fut brutal : abandon progressif du papier, recentrage sur le digital natif, refonte complète des systèmes IT… S’il fallait résumer l’audace de La Redoute : accepter de tuer son business historique pour ne plus vivre que par les flux digitaux. Rares sont les enseignes françaises ayant eu ce discernement avant la noyade.
Opinion : stratégie ou baroud d’honneur ?
Soyons francs : cette transformation radicale était-elle un choix éclairé ou simplement la dernière planche de salut possible face à une obsolescence programmée ? Il y a certes eu regain d’agilité et rajeunissement de l’image… mais la concurrence féroce des géants digitaux laisse peu de répit. La Redoute reste un cas d'école — mais attention, tous n’en sortent pas grandis.
Le paysage médiatique : Rue89, Mediapart, et la presse en ligne.
Chez les médias aussi, certains ont joué la carte pure player jusqu’au boutisme.
- Mediapart : né sans version papier ni héritage éditorial poussiéreux, ce site mise tout sur l’abonnement numérique pour garantir son indépendance (les mauvaises langues diront « élitisme payant », mais il fallait oser).
- Rue89 : lancé comme pure player provoc’ au début des années 2000 par des transfuges de Libération, ce site fit trembler le petit monde médiatique avant d’être absorbé par L’Obs. Son ADN originel – info interactive/no bullshit – aura marqué son temps malgré sa fin peu glorieuse sous forme semi-hybride.
- Slate France, BuzzFeed, Vice Media incarnent eux aussi cette génération sans attaches papier, jouant le jeu du contenu viral et monétisant via pub programmatique ou brand content – parfois jusqu’à l’épuisement du modèle (cf Vice Europe).
Le point commun ? Une logique économique basée soit sur l’abonnement pur (« hard paywall »), soit sur une ingénierie publicitaire algorithmique débridée — rarement les deux sans dégâts collatéraux côté crédibilité journalistique.
Mention spéciale au Spiil (Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne) qui tente vaille que vaille d’assurer un minimum de représentativité à ces acteurs ni tout à fait mainstream ni vraiment marginaux.
Trop peu nombreux ou trop atypiques ? Peut-être… Mais ils forcent le secteur entier à se renouveler ou disparaître : avenir numérique de la presse.
Modèles émergents : Zooplus, Airbnb, Leboncoin et leurs spécificités
L’équation pure player ne se limite pas au retail classique – avouez-le : on aurait tort de réduire ce modèle aux sites vendant des baskets blanches ou des casques audio !
- Airbnb : plateforme totalement digitale dans son approche initiale (l’hébergement entre particuliers n’a jamais eu pignon sur rue), elle exploite uniquement le web pour orchestrer ses mises en relation mondiales. Sans app ni site internet performant : rien n’existe !
- Leboncoin : temple français du marché C2C localisé — là encore aucun magasin physique ni bureau ouvert au public ; toute la valeur provient du matching algorithmique entre offre/demande régionale.
- Zooplus : leader européen dans l’animalerie online – pas un seul sac croquettes vendu IRL ! La logistique y est aussi invisible qu’efficace pour l’internaute lambda.
Ces exemples démontrent que le champ du pure player s’étend bien au-delà du commerce classique — plateformes collaboratives incluses. Leur réussite tient quasi exclusivement à leur capacité à digitaliser intégralement chaque étape métier… quitte parfois à mépriser outrageusement toute dimension humaine ou locale dans leur processus (mais c’est un autre débat).
Le piège de la diversification : quand un pure player s’aventure hors de son pré carré.
Certains pure players grisés par leurs succès tentent alors l’aventure hors-piste : ouverture de boutiques éphémères (« pop-up »), extension vers des services offline ou multiplication hasardeuse des canaux… L’intention paraît louable — toucher plus large — mais elle se heurte bien souvent à une réalité impitoyable : perte brutale d’agilité organisationnelle et dilution irréversible du capital marque. Les cas récents où cette fuite en avant a précipité la chute sont légion; sans vouloir froisser ceux qui croient encore pouvoir être partout sans être nulle part… Il suffit cependant d’une mauvaise diversification pour perdre ce qui faisait justement sa force initiale :
l’unicité digitale.
Atouts et faiblesses du modèle pure player
L’agilité comme super-pouvoir, ou comment pivoter à la vitesse de la lumière
On ne s’y trompe pas : le vrai luxe des pure players n’a rien à voir avec un bureau design ou une mascotte mal dessinée. Leur force, c’est l’absence de boulets aux pieds. Sans réseau de boutiques coûteuses et sans héritage organisationnel antédiluvien, ces acteurs du tout-digital sont capables de pivoter leur offre, leur interface ou leur positionnement en temps réel – littéralement du jour au lendemain. Une nouvelle tendance TikTok ? On réorganise la home page en une journée. Un bug critique ? On patch sans attendre que le siège régional daigne valider. Cette capacité d’adaptation foudroyante, impossible dans une enseigne classique engourdie par ses strates hiérarchiques, explique pourquoi les pure players captent si souvent les innovations digitales avant tout le monde (source : le-site-francais.fr).
Sans vouloir froisser les partisans du "processus long" : cette souplesse n’est pas un gadget… c’est la clé de survie sur un marché où l’effet de mode fait et défait des empires numériques tous les trimestres.
La connaissance client : l’arme absolue (à manier avec discernement)
Avouez-le, le fantasme du data-driven n’a jamais été aussi galvaudé qu’en 2024. Mais chez les pure players, on ne parle pas d’un vague CRM rempli à moitié ou d’un fichier Excel poussiéreux : chaque clic, chaque abandon de panier, chaque scroll est traqué, analysé, recroisé avec une finesse dont la CNIL raffole peu. Résultat : une connaissance client qui frôle parfois l’obsession clinique. Zalando avoue lui-même que c’est « l’enjeu principal » pour s’imposer sur un marché saturé… et ce n’est franchement pas qu’une posture (source : Alexandre Pomi, DG France).
Les meilleurs pure players exploitent ces insights pour personnaliser l’expérience utilisateur jusqu’à la caricature : recommandations ultra-ciblées, promos qui tombent à pic… Mais attention à ne pas verser dans la manipulation algorithmique grotesque — certains clients finissent par quitter le navire si tout sent trop fort la surveillance personnalisée.
Les défis logistiques et opérationnels : revers cinglant du modèle numérique
Sur le papier, tout paraît fluide : automatisation magique des commandes, livraison express et retours simplifiés en trois clics… Mais derrière ce vernis se cachent des défis monstrueux. Stockage éclaté sur plusieurs entrepôts obscurs (souvent sous-traités), gestion imprévisible du dernier kilomètre (merci Chronopost), politique de retour souvent suicidaire pour préserver les taux de conversion… Le cauchemar logistique est permanent. Il faut jongler entre optimisation algorithmique et réalité physique – une commande perdue ou un colis endommagé ruinent en un tweet des mois d’efforts marketing.
Et ne parlons même pas du service client digitalisé à outrance : chatbots incompétents qui font rager tout le monde, absence totale d’interlocuteur humain compétent... On aurait pu rêver mieux comme expérience après-vente.
La concurrence "Click and Mortar" : David contre Goliath version SaaS
Soyons honnêtes : la grande distribution n’a jamais digéré qu’on lui vole sa clientèle avec trois interfaces web bien pensées. Armés de budgets marketing délirants et d’un maillage omnicanal quasi militaire (magasins + e-commerce + applis), les click and mortar disposent d’un avantage structurel impossible à répliquer pour nombre de pure players indépendants [Impact du digital sur le retail traditionnel].
Les derniers chiffres montrent que les sites hybrides génèrent davantage de points de contact clients — preuve que la complémentarité rassure toujours une majorité d’acheteurs hésitants... Sans vouloir froisser ceux qui croient encore au mythe du « numérique pur » invincible : seuls les pure players ayant trouvé une verticalité ultra-spécifique ou une communauté engagée peuvent espérer résister durablement au rouleau compresseur omnicanal.
Fidélisation dans l’ère du zapping : marcher sur des œufs numériques
Réalité cruelle mais incontournable : fidéliser un internaute aujourd’hui relève presque du miracle industriel. À l’heure où chaque concurrent est accessible en deux clics depuis Google Shopping ou Instagram Ads, faire revenir un client nécessite plus qu’un code promo ridicule ou une newsletter intrusive.
La solution consiste à combiner expérience personnalisée (merci la data), excellence opérationnelle (livraison rapide ET fiable – si possible), et animation communautaire sincère – sans quoi tout client décampe dès que surgit mieux ailleurs ou moins cher."Veepee", ex Vente-Privée croit dur comme fer que placer l’humain au centre reste payant… mais combien y parviennent réellement ?
On aurait pu rêver mieux comme eldorado fidélitaire – mais dans ce secteur où tout invite au mouvement perpétuel (prix barrés illimités, offres flash hystériques), seuls survivent ceux qui transforment chaque interaction en valeur ajoutée tangible.
Le "Pure Player" en France : une démographie à observer
La France cultive une population de pure players qui, même si elle ne rivalise pas (encore) avec la Silicon Valley, parvient à irriguer des secteurs d’activité étonnamment variés. Sans vouloir froisser ceux qui s’attendent au sempiternel trio Amazon-eBay-Zalando, il faut reconnaître que le e-commerce national sait se défendre : pensons à Cdiscount, Showroomprivé, ou encore ManoMano sur la bricole – tous exclusivement digitaux, et taillés pour l’arène hexagonale. Mais la vraie surprise vient du côté des médias, notamment régionaux, où l’on observe un foisonnement de pure players agiles et mordants : Zinfos 974 à La Réunion, Marsactu à Marseille, Objectif Gard, Mediabask dans le Pays basque, les déclinaisons locales de Rue89 (Lyon, Strasbourg, Bordeaux), mais aussi des titres engagés comme Mediacités, ou plus confidentiels tels que le Télescope d’Amiens, Dijonscope, Essonne info et Carré d’info.
L’industrie des services numériques n’est pas en reste : plateformes SaaS (Doctolib), fintech (Qonto), mobilité urbaine (Blablacar)… On aurait pu rêver mieux côté politique de soutien public ou fiscalité adaptée, mais la vitalité du secteur montre que même sans plan Marshall digital officiel, l’écosystème sait faire germer des acteurs 100% online capables de disrupter leur marché.

Pure Player : une définition en constante évolution
Soyons lucides : la prétendue pureté du modèle « pure player » s’érode à mesure que le marché numérique se complexifie. Les frontières jadis étanches entre digital et physique fondent sous les coups de boutoir des stratégies omnicanales, de la diversification forcée et des attentes clients toujours plus volatiles. Hier encore signe distinctif, l’exclusivité web n’est plus qu’une option parmi d’autres dans l’arsenal stratégique — certains pure players n’hésitent plus à ouvrir des pop-ups ou à investir IRL pour survivre.
Avouez-le, la définition stricte du "pure player" est déjà en voie d’obsolescence, bousculée par l’hybridation constante des modèles économiques. On ne s’y trompe pas : demain, ce terme pourrait très bien paraître daté, balayé par une nouvelle génération de concepts plus larges et adaptatifs. Le monde digital s’invente chaque matin – et personne ne sait franchement quelle étiquette sera encore valable dans deux ans.






